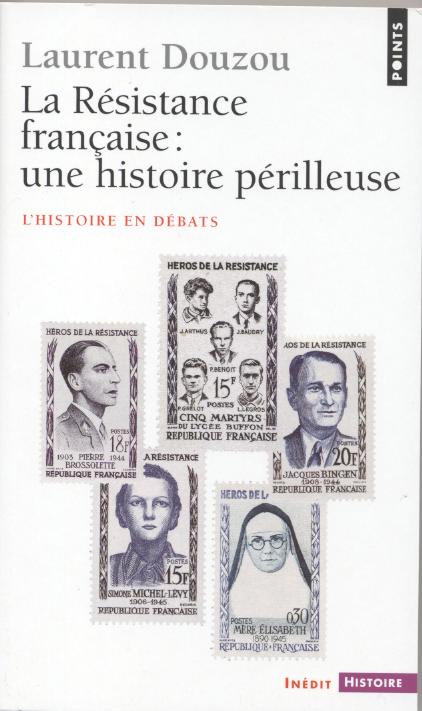|
La Résistance française, une histoire périlleuse
Laurent Douzou
Paris, Edition du Seuil, collection Points-Histoire, 2005
Ce premier essai d’historiographie de la Résistance paraît directement en poche dans une collection de référence – marquée notamment par la parution, en 2004, de Penser la Grande Guerre, d’Antoine Prost et Jay Winter. L’évolution retracée par Laurent Douzou n’est pas sans point commun avec ce dernier ouvrage, dans la description des transformations de l’écriture de leur objet d’étude. Car, pour l’une comme pour l’autre des deux guerres mondiales du XXe siècle, les vingt dernières années ont été marquées par élargissement des perspectives vers une description des « sociétés en guerre » où combattants et résistants sont désormais analysés dans leur relation avec le reste du corps social et en tant que « micro-sociétés ».
Cependant, s’il y a un débat commun à ces deux historiographies, c’est la question récurrente du statut du témoignage, immédiatement posée par les historiens et les acteurs eux-mêmes devant la floraison des souvenirs parus dès la fin de chacun des conflits, mais qui continue à diviser les historiens. En même temps qu’il livre une mine d’informations pour « l’honnête homme » désireux de trouver des repères solides dans le dédale des publications sur la Résistance, l’ouvrage de Laurent Douzou apporte avant tout une contribution essentielle à la clarification de ce débat
Le légendaire, comme le rappelle d’abord l’auteur, est constitutif de l’histoire même de la Résistance, y compris pour ses acteurs les plus épris de rigueur historique: si l’agrégé d’histoire Brossolette compare à Londres ses camarades morts aux héros d’Homère, ce n’est pas un pur effet de propagande. Comme la « belle mort » des héros grecs, la mort des Résistants a pour leur camarades un sens moral, qui implique que les motivations et les actes de ceux-ci doivent être connus et proclamés, parce qu’ils participent de la constitution d’une élite. On songe à l’expression du résistant Henri Frenay dans Combat (janvier 1943) : « Les hommes se jugent à leur valeur morale, sur l’identité entre leur parole et leurs actes ». Pour nombre de résistants, leur engagement, authentifié par le risque de la mort, est vécu comme le creuset d’une relève destinée à pallier la faillite des élites traditionnelles en 1940. Cependant, ceci n’empêche pas ceux qui veulent narrer dès cette époque l’expérience résistante (Kessel, Char) d’exprimer la difficulté de décrire un phénomène qui peut prendre la forme d’un « héroïsme » au quotidien ou collectif, de rendre compte aussi du bonheur paradoxal procuré par la densité de la vie clandestine, incomparable au temps de paix (cf. l’image d’une « paradisiaque période d’enfer » employée par Jacques Bingen).
Cette vision initiale d’une dette à assumer, d’une histoire utile à la Nation, mais aussi d’un défi méthodologique explique qu’après la Libération, la Résistance soit au premier plan des méthodes d’élaboration d’une histoire du temps présent prônées par le Comité d’histoire de la Guerre. Présidé par Lucien Febvre, assisté d’Henri Michel, celui-ci pilote notamment la mise en place d’un réseau de correspondants départementaux, une campagne de recueil de plus de 1 500 témoignages pendant près de dix ans, une campagne à plus long terme de préservation et de collecte de documents.
Ayant expérimenté cette étape qui consistait en fait à « inventer » les sources d’une histoire future, le Comité n’hésite pas non plus à encourager dès 1955la rédaction de travaux universitaires, contre les règles de distance temporelle en vigueur dans l’université, et à les confier à des historiens ayant appartenu à la Résistance (la collection « Esprit de la Résistance » aux PUF) tout en incitant des étudiants à s’y lancer.
En déduire de cet appel constant aux acteurs eux-mêmes que le Comité ait entrepris de faire une « histoire pieuse » serait donc faire une erreur profonde de perspective. C’est Febvre, chef de file de l’École des Annales, qui incite les acteurs et les témoins de l’occupation à prendre la plume, pour « donner leur version des événements », se méfiant par avance d’une histoire qui serait élaborée uniquement à froid par les générations futures ! Et de fait, force est de constater que les témoignages recueillis par le Comité continuent d’être une source irremplaçable pour les études les plus récentes sur la Résistance. Par ailleurs, il est frappant de voir que les historiens-résistants du Comité eux-mêmes ont eu à subir les reproches de leurs camarades, qui ne se reconnaissaient pas dans une histoire « desséchée ». De fait, pris entre la parole des témoins et les exigences de l’Université, c’est plutôt un ultra-positivisme que traduit l’initiative la moins fructueuse du Comité, l’établissement d’une chronologie nationale des faits de Résistance, condamnée à l’impasse par manque de réflexion préalable sur la définition même de la Résistance.
Si l’histoire de la Résistance a considérablement évolué depuis les années 1970, c’est pour des raisons très hétérogènes. Certes, il y a la disponibilité très progressive des archives : la loi de 1979 a représenté le palier le plus important ce de point de vue ; le retard pris par l’histoire des réseaux rattachés au BCRA et, à plus forte raison, au SOE ou à l’IS britannique, lui est largement dû. Mais le changement progressif de perspective intégrant l’histoire sociale et culturelle, commun, on l’a vu, à l’étude des deux guerres mondiales, est un facteur aussi décisif pour expliquer le renouvellement des problématiques. C’est lui qui explique, par exemple, la multiplication d’études collectives sur les femmes, les étrangers, les Juifs dans la Résistance, présents en tant qu’individus dans l’historiographie antérieure. C’est lui surtout qui a permis, après la remise radicale en question, dans les années 1970, du mythe de « l’esprit de Résistance » des Français, de parvenir à une analyse dynamique de la relation entre la Résistance et les Français, tenant compte des représentations et comportements spécifiques à un régime d’occupation et des besoins des organisations clandestines.
Enfin, parler de passage « de la mémoire à l’Histoire » est caricaturer le rôle singulier des acteurs dans cette historiographie. Leur discours n’a été ni lénifiant ni immuable, mais celui d’acteurs conscients de jouer leur rôle nécessaire dans une histoire amenée à évoluer : les divisions internes à la Résistance n’ont pas été occultées (des mémoires du colonel Passy aux ouvrages d’Henri Noguères), de nouveaux témoignages ont joué un rôle décisif dans les tournants historiographiques (qu’on songe à la parole libérée des communistes Pannequin et Tillon), la conscience chez les résistants de la difficulté de comprendre leur propre expérience est assumée et intégrée à leur récit aussi bien chez un Jean Cassou dans les années 50 que chez un Philippe Viannay trente ans plus tard.
Surtout, le renouvellement récent de l’historiographie de la Résistance est en partie dû à des acteurs devenus historiens : Daniel Cordier et Jean-Louis Crémieux-Brilhac. Bien plus, Laurent Douzou relève le nouveau type d’écriture à l’œuvre chez certains enfants de résistants (Waysand, Aude Yung de Prévaux, François Maspéro), qui font de l’enquête familiale une quête identitaire, nourrie de l’historiographie savante. Le monopole futur d’une histoire « froide » sur ce que qui continue à être un phénomène peut-être aussi décisif pour l’identité nationale que la Révolution Française est sans doute une illusion.
Bruno Leroux
©Fondation de la Résistance . Droits réservés
|