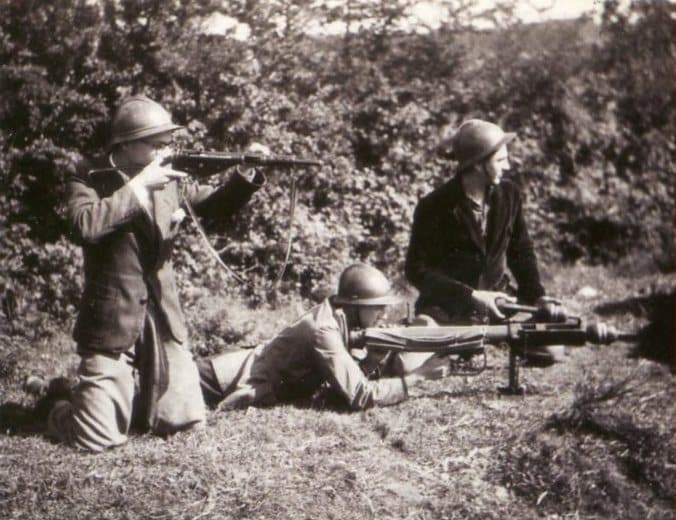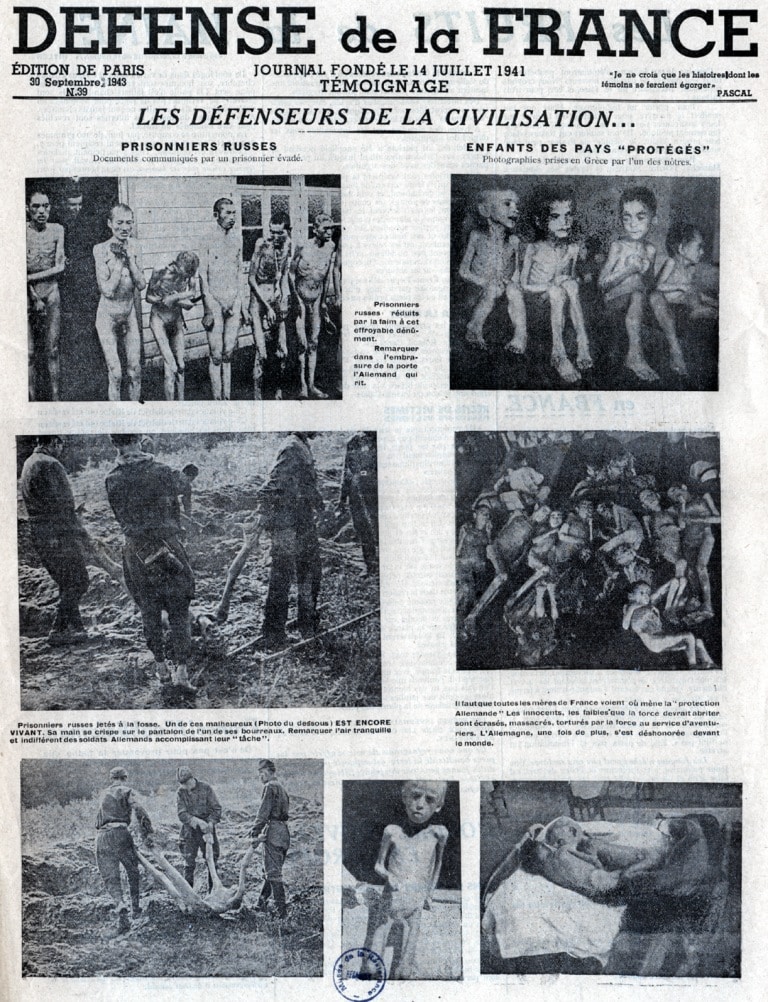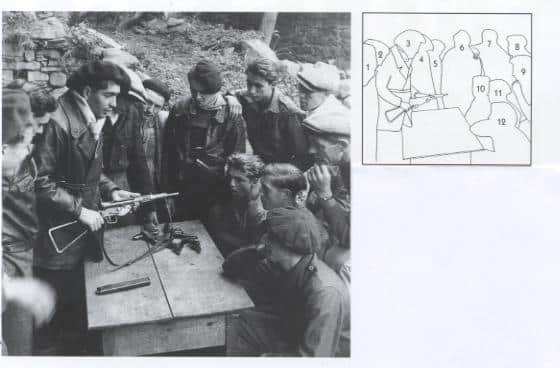Emmanuel Debono
AUTOUR D’UN FILM Le film :La Libération de Paris. Histoire, enjeux, analyse.
Avec les textes de Sylvie Lindeperg et de Jean-Pierre Bertin-Maghit On trouvera dans le numéro 37 de juin 2004 de la Lettre de la fondation le texte ci-dessous accompagné des documents iconographiques : http://www.fondationresistance.org/documents/lettre/LettreResistance037.pdf Le DVD-ROM sur la Résistance en Ile-de-France réalisé par l’Association pour des études sur la Résistance intérieure (AERI) est paru en 2004. Outre les centaines de notices (biographies, événements, monographies…) qu’il met à la disposition du lecteur, il rassemble une riche iconographie et de nombreuses séquences audiovisuelles ou sonores. Parmi ces séquences, le DVD présente dans son intégralité un film de 32 minutes tourné par les opérateurs du Comité de Libération du Cinéma français (CLCF) durant les journées de l’insurrection parisienne : le Journal de la Résistance. Nous proposons ici de rappeler la genèse de cette entreprise exceptionnelle, ses enjeux et sa réception par le public. Nous présentons par la suite le traitement qui en a été fait dans le cadre du DVD-ROM ainsi que quelques exemples d’analyse. Aux origines du film : L’idée de réaliser un film sur la Libération est venue d’Hervé Missir, reporter d’actualités, après le débarquement allié en Normandie. Au 78 avenue des Champs-Élysées, quartier général du CLCF, celui-ci s’entoure d’une équipe de techniciens: Nicolas Hayer (chef opérateur), l’écrivain René Blech (responsable de la section cinéma du Front national), Roger Mercanton (monteur), André Zwobada (réalisateur) et Jean Jay (ancien directeur de l’Association de la presse filmée). À l’origine, le film sur la libération de Paris est conçu comme un témoignage sur l’insurrection parisienne mais aussi comme le numéro zéro des futures actualités libres que le CLCF entend diffuser dans toutes les salles des territoires libérés. Il refuse de laisser le monopole aux actualités américaines Le Monde libre, seul journal projeté depuis le 6 juin dans la France libre. Le travail est planifié. La capitale est divisée en dix secteurs. Nicolas Hayer prend la tête d’une véritable troupe d’opérateurs répartis en équipes de deux ou trois : il s’agit d’anciens journalistes de Gaumont, Pathé ou Éclair, employés à France-Actualités depuis 1942, et d’indépendants. Parmi eux se trouvent Robert Petiot, Robert Batton, Georges Méjat, Pierre Léandri, Georges Barrois, Joseph Krzypow, Yves Naintré, François Delalande, Georges Madru, Albert Mahuzier, Philippe Agostini (directeur de la photo), René Dora, Marcel Grignon, Gilbert Larriaga… Des liaisons sont établies avec les studios et les entrepôts pour récupérer pellicule et matériel. Les réunions se multiplient, appartements, plateaux, laboratoires sont utilisés alternativement. À l’approche du ...