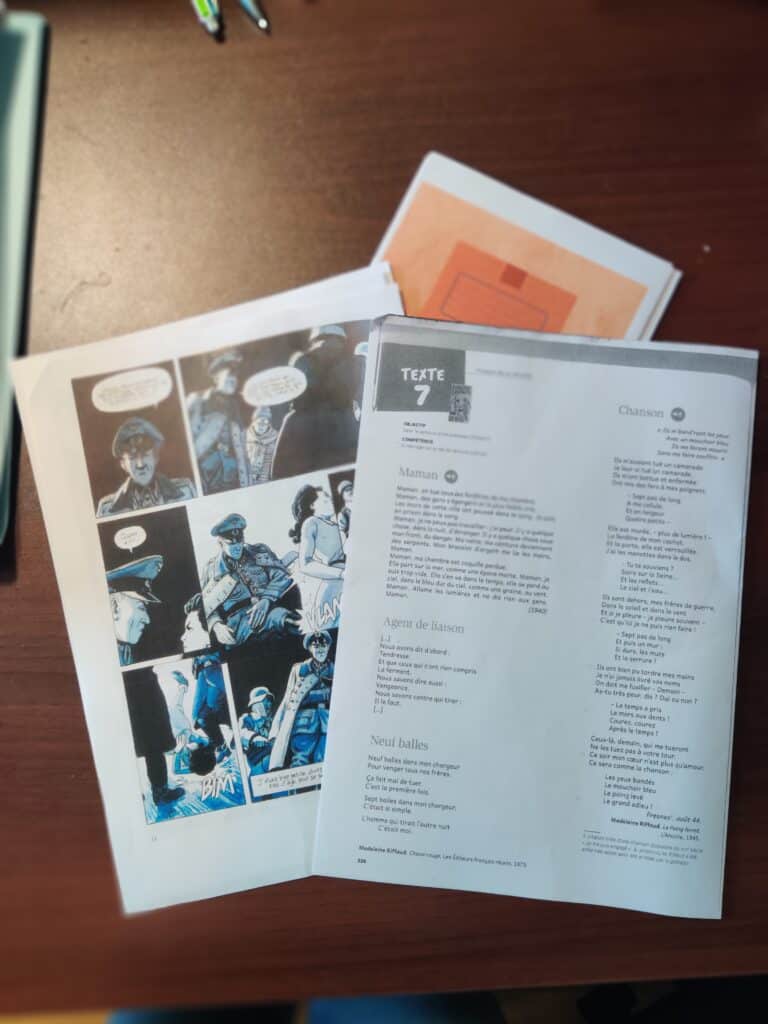Explorer les actualités
Pédagogie
7 janvier 2014
Présentation du thème du CNRD à Lyon
Le thème du CNRD 2014-2015 sera présenté au CHRD de Lyon le 21 janvier 2014 de 9h à 16h30. Interviendront: Philippe BUTTON: la libération du territoire 1944-1946 Philippe Hanus et Olivier Vallade: l’expérience de la République du Vercors. Monsieur Jacques Vistel, président de la Fondation de la Résistance Ces interventions seront suivies de la présentation des ressources locales et nationales sous la présidence de Catherine Verceuil, IPR d’histoire-géographie de l’Académie de Lyon.
Pédagogie
7 janvier 2014
CNRD 2013-2014 -Brochures et témoignages disponibles
Afin de trouver des connaissances complémentaires à la brochure coordonnée par la Fondation de la Résistance, nous vous conseillons de consulter les brochures et les propositions suivantes: -la brochure du CNRD du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon http://citadelle.com/fr/le-musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/education-et-recherche/cnrd.html -la brochure du CNRD du Musée de la Résistance et de la Déportation de Toulouse http://www.musee-resistance31.fr/ -la brochure du CNRD du département de l’Hérault (archives départementales, Comité départemental du CNRD, Académie de Montpellier, centre régional de la Résistance et de la Déportation) http://pierresvives.herault.fr/ressource/concours -des témoignages librement téléchargeables sur le site du USC Shoah Foundation USC Shoah Foundation -La brochure du CHRD de Lyon http://www.chrd.lyon.fr/chrd/sections/fr/espace_pedagogique/activites_enseignant -La proposition pédagogique du Musée de l’Education du Val d’oise http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1109
Actualité
7 janvier 2014
Exposition La Libération de Paris- Musée Carnavalet
Exposition au Musée Carnavalet :Paris libéré, Paris photographié, Paris exposé du mercredi 11 juin 2014 au 8 février 2015 Dès novembre 1944 alors que la guerre n’est pas terminée, le musée Carnavalet consacrait à la Libération de Paris une exposition. Soixante-dix ans plus tard, le musée dévoile un fonds exceptionnel de photographies restituant les évènements d’août 1944. S’y ajoutent des documents audiovisuels, des objets et et la participation d’un artiste contemporain. Musée Carnavalet, 16 rue des Francs-Bourgeois 75003 Pariset sur www.carnavalet.paris.fr
Actualité
7 janvier 2014
Ciné-Histoire- Joseph Epstein
Ciné-Histoire a le plaisir de vous inviter à la première séance du cycle, « Ces résistants à ne pas oublier »:Joseph Epstein dit « Colonel Gilles », celui qui n’était pas sur l’affiche rouge. Lundi 13 janvier 2014 à 14h30: projection du film de Pascal Convert, Joseph Epstein bon pour la légende La projection sera suivie de l’intervention de Georges Duffau Epstein, fils de Joseph Epstein. Lieu: Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau, 75004 Paris
Pédagogie
23 décembre 2013
Présentation du thème du CNRD à Dijon
La présentation du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2013/2014 aura lieu à DIJON le 23 janvier 2014, à l’amphithéâtre « Aristote » de l’Université de Bourgogne, avec l’aide du Service Départemental de l’ONAC
Pédagogie
23 décembre 2013
Présentation du thème du CNRD à Vannes
Présentation du thème du C.N.R.D. 2013/2014 à VANNES La présentation du Concours National de la Résistance et de la Déportation (C.N.R.D.) 2013/2014 La Libération du territoire et le retour à la République aura lieu à VANNES le 23 janvier 2014. au Palais des Arts à Vannes, Place Anne de Bretagne de 9h à 11h30, accueil à partir de 8h45 INTERVENANTS : Présidente de séance : Yvette LECOMTE Jacqueline SAINCLIVIER Loïc BOUVARD Jean NOVOSSELOFF Hubert POUPARD Florent LENEGRE